Guy de Maupassant : Mont-Oriol. Préoriginale de ce chapitre publiée dans Gil Blas du 26 au 28 décembre 1886.
| Chapitre I — | Première Partie, Chapitre II | — Chapitre III |
II
Le déjeuner fut long comme sont les repas de table d’hôte. Christiane, qui ne connaissait pas tous ces visages, causait avec son père et avec son frère. Puis elle monta se reposer jusqu’au moment où devait sauter le morne.
Elle fut prête bien avant l’heure et força tout le monde à partir pour ne point manquer l’explosion.
À la sortie du village, au débouché du vallon, s’élevait en effet une haute butte, presque un mont, qu’ils gravirent sous un ardent soleil en suivant un petit sentier entre les vignes. Quand ils parvinrent au sommet, la jeune femme poussa un cri d’étonnement devant l’immense horizon déployé soudain sous ses yeux. En face d’elle s’étendait une plaine infinie qui donnait aussitôt à l’âme la sensation d’un océan. Elle s’en allait, voilée par une vapeur légère, une vapeur bleue et douce, cette plaine, jusqu’à des monts très lointains, à peine aperçus, à cinquante ou soixante kilomètres, peut-être. Et sous la brume transparente, si fine, qui flottait sur cette vaste étendue de pays, on distinguait des villes, des villages, des bois, les grands carrés jaunes des moissons mûres, les grands carrés verts des herbages, des usines aux longues cheminées rouges et des clochers noirs et pointus bâtis avec les laves des anciens volcans.
« Retourne-toi », dit son frère. Elle se retourna. Et, derrière elle, elle vit la montagne, l’énorme montagne bosselée de cratères. C’était d’abord le fond d’Enval, une large vague de verdure où on distinguait à peine l’entaille cachée des gorges. Le flot d’arbres escaladait la pente rapide jusqu’à la première crête qui empêchait de voir celles du dessus. Mais comme on se trouvait tout juste sur la ligne de séparation des plaines et de la montagne, celle-ci s’étendait à gauche, vers Clermont-Ferrand, et s’éloignant, déroulait sur le ciel bleu d’étranges sommets tronqués, pareils à des pustules monstrueuses : les volcans éteints, les volcans morts. Et là-bas, tout là-bas, entre deux cimes, on en apercevait une autre, plus haute, plus lointaine encore, ronde et majestueuse, et portant à son faîte quelque chose de bizarre qui ressemblait à une ruine.
C’était le Puy de Dôme, le roi des monts auvergnats, puissant et lourd, et gardant sur sa tête, comme une couronne posée par le plus grand des peuples, les restes d’un temple romain.
Christiane s’écria : « Oh ! que je serai heureuse ici. » Et elle se sentait heureuse déjà, pénétrée par ce bien-être qui envahit la chair et le cœur, vous fait respirer à l’aise, vous rend alerte et léger quand on entre tout à coup dans un pays qui caresse vos yeux, qui vous charme et vous égaye, qui semblait vous attendre, pour lequel vous vous sentez né.
On l’appelait : « Madame, madame ! » Et elle aperçut plus loin le docteur Honorat, reconnaissable à son grand chapeau. Il accourut et conduisit la famille vers l’autre versant du coteau sur une pente de gazon, à côté d’un bosquet de petits arbres, où une trentaine de personnes attendaient déjà, étrangers et paysans mêlés.

Sous leurs pieds, la côte rapide descendait jusqu’à la route de Riom, ombragée par les saules abritant sa mince rivière ; et, au milieu d’une vigne au bord de ce ruisseau, s’élevait une roche pointue que deux hommes agenouillés à son pied semblaient prier. C’était le morne.
Les Oriol, père et fils, attachaient la mèche. Sur la route une foule curieuse regardait, précédée par une ligne plus basse et agitée de gamins.
Le docteur Honorat avait choisi une place commode pour Christiane qui s’assit, le cœur battant, comme si elle allait voir sauter avec la roche toute cette population. Le marquis, Andermatt et Paul Brétigny se couchèrent sur l’herbe à côté de la jeune femme, tandis que Gontran restait debout. Il dit, d’un ton blagueur :
— Mon cher docteur, vous êtes donc beaucoup moins pris que vos confrères qui n’ont certes pas une heure à perdre pour venir à cette petite fête ?
Honorat répondit avec bonhomie :
— Je ne suis pas moins occupé ; seulement mes malades m’occupent moins... Et puis, j’aime mieux distraire mes clients que les droguer.
Il avait un air sournois qui plaisait beaucoup à Gontran.
D’autres personnes arrivaient, des voisins de table d’hôte, les dames Paille, deux veuves, la mère et la fille, les Monécu père et fille, et un gros homme tout petit qui soufflait comme une chaudière crevée, M. Aubry-Pasteur, ancien ingénieur des mines, qui avait fait fortune en Russie.
Le marquis et lui s’étaient liés. Il s’assit à grand-peine avec des mouvements préparatoires, circonspects et prudents, qui amusèrent beaucoup Christiane. Gontran s’était éloigné pour voir les figures des autres curieux venus, comme eux, sur la butte.
Paul Brétigny indiquait à Christiane Andermatt les pays aperçus au loin. C’était Riom d’abord qui faisait une tache rouge, une tache de tuiles dans la plaine ; puis Ennezat, Maringues, Lezoux, une foule de villages à peine distincts, qui marquaient seulement d’un petit trou sombre la nappe interrompue de verdure, et là-bas, tout là-bas, au pied des montagnes du Forez, il prétendit lui faire distinguer Thiers.
Il disait, s’animant :
— Tenez, tenez, devant mon doigt, juste devant mon doigt. Je vois très bien, moi.

Elle ne voyait rien, elle, mais elle ne s’étonna pas qu’il vît, car il regardait comme les oiseaux de proie, avec ses yeux ronds et fixes, qu’on sentait puissants comme des lunettes marines.
Il reprit :
— L’Allier coule devant nous, au milieu de cette plaine, mais il est impossible de l’apercevoir. Il est trop loin, à trente kilomètres d’ici.
Elle ne cherchait guère à découvrir ce qu’il indiquait, car elle attachait sur le morne tout son regard et toute sa pensée. Elle se disait que, tout à l’heure, cette grosse pierre n’existerait plus, qu’elle s’envolerait en poudre, et elle se sentait prise d’une vague pitié pour la pierre, d’une pitié de petite fille pour un joujou cassé. Elle était là depuis si longtemps, cette pierre ; et puis elle était jolie, elle faisait bien. Les deux hommes, relevés à présent, entassaient des cailloux à son pied, bêchant avec des mouvements rapides de paysans pressés.
La foule de la route, sans cesse accrue, s’était rapprochée pour voir. Les mioches touchaient les deux travailleurs, couraient et remuaient autour d’eux comme de jeunes bêtes en gaieté ; et de la place élevée où se tenait Christiane, ces gens avaient l’air tout petits, une foule d’insectes, une fourmilière en travail. Le murmure des voix montait, tantôt léger, à peine perceptible, tantôt plus vif, une rumeur confuse de cris et de mouvements humains, mais émiettée dans l’air, évaporée déjà, une sorte de poussière de bruit. Sur la butte aussi la foule augmentait, arrivant sans cesse du village, et couvrait la pente dominant le rocher condamné.
On s’appelait, on se réunissait par hôtels, par classes, par castes. Le plus bruyant des attroupements était celui des acteurs et musiciens, présidé, gouverné par leur directeur, Petrus Martel de l’Odéon, qui avait abandonné, en cette circonstance, sa partie de billard enragée.
Le front coiffé d’un panama, les épaules couvertes d’une veste d’alpaga noir, qui laissait saillir en bosse un large ventre blanc, car il jugeait le gilet inutile aux champs, l’acteur moustachu prenait des airs de commandement, indiquait, expliquait et commentait tous les mouvements des deux Oriol. Ses subordonnés, le comique Lapalme, le jeune premier Petitnivelle et les musiciens, le maestro Saint-Landri, le pianiste Javel, l’énorme flûtiste Noirot, la contrebasse Nicordi, l’entouraient et l’écoutaient. Devant eux, trois femmes étaient assises, abritées par trois ombrelles, une blanche, une rouge et une bleue, qui formaient sous le soleil de deux heures un étrange et éclatant drapeau français. C’étaient Mlle Odelin la jeune actrice, sa mère, une mère de location disait Gontran, et la caissière du café, société habituelle de ces dames. L’arrangement de ces ombrelles aux couleurs nationales était une invention de Petrus Martel qui, ayant remarqué, au début de la saison, la bleue et la blanche aux mains des dames Odelin, avait fait cadeau de la rouge à sa caissière.

Tout près d’eux, un autre groupe attirait également l’attention et le regard, celui des chefs et marmitons des hôtels, au nombre de huit, car une lutte s’était engagée entre les gargotiers qui avaient envestonné de toile, pour impressionner les passants, jusqu’à leurs laveurs de vaisselle. Tous debout, ils recevaient sur leurs toques plates la lumière crue du jour, et présentaient, en même temps, l’aspect d’un état-major bizarre de lanciers blancs et d’une délégation de cuisiniers.
Le marquis demanda au docteur Honorat :
— D’où vient tout ce monde ? Je n’aurais jamais cru Enval aussi peuplé !
— Oh ! On est venu de partout, de Châtel-Guyon, de Tournoël, de La Roche-Pradière, de Saint-Hippolyte. Car voilà longtemps qu’on parle de ça dans le pays ; et puis le père Oriol est une célébrité, un personnage considérable par son influence et par sa fortune, un véritable Auvergnat d’ailleurs, resté paysan, travaillant lui-même, économe, entassant or sur or, intelligent, plein d’idées et de projets pour ses enfants.
Gontran revenait, agité, l’œil brillant. Il dit, à mi-voix :
— Paul, Paul, viens donc avec moi, je vais te montrer deux jolies filles ; oh ! mais gentilles, tu sais !
L’autre leva la tête et répondit :
— Mon cher, je suis très bien ici, je ne bougerai pas.
— Tu as tort. Elles sont charmantes.
Puis, élevant la voix :
— Mais le docteur va me dire qui c’est. Deux fillettes de dix-huit ou dix-neuf ans, des espèces de dames du pays, habillées drôlement, avec des robes de soie noire à manches collantes, des espèces de robes d’uniforme, des robes de couvent, deux brunes...
Le docteur Honorat l’interrompit :
— Cela suffit. Ce sont les filles du père Oriol, deux belles gamines en effet, élevées chez les Dames noires de Clermont... et qui feront de beaux mariages... Ce sont deux types, mais là deux types de notre race, de la bonne race auvergnate ; car je suis Auvergnat, monsieur le marquis ; et je vous montrerai ces deux enfants-là...
Gontran lui coupa la parole et, sournois :
— Vous êtes le médecin de la famille Oriol, docteur ?
L’autre comprit la malice, et répondit un simple « Parbleu ! » plein de gaieté.
Le jeune homme reprit :
— Comment êtes-vous parvenu à gagner la confiance de ce riche client ?
— En lui ordonnant de boire beaucoup de bon vin.
Et il raconta des détails sur les Oriol. Il était un peu leur parent d’ailleurs, et les connaissait de longtemps. Le vieux, le père, un original, était très fier de son vin ; et il avait surtout une vigne dont le produit devait être absorbé par la famille, rien que par la famille et les invités. Dans certaines années, on arrivait à vider les fûts que donnait ce vignoble d’élite, mais dans certaines autres on y parvenait à grand-peine.
Vers le mois de mai ou de juin, quand le père voyait qu’il serait malaisé de boire tout ce qui restait encore, il se mettait à encourager son grand fils, Colosse, et il répétait : « Allons, fils, faut y parfaire. » Alors ils commençaient à se verser dans la gorge des litres de rouge, du matin au soir. Vingt fois, pendant chaque repas, le bonhomme disait d’un ton grave, en penchant le broc sur le verre de son garçon : « Faut y parfaire. » Et comme tout ce liquide chargé d’alcool lui échauffait le sang et l’empêchait de dormir, il se relevait la nuit, passait une culotte, allumait une lanterne, réveillait « Coloche » ; et ils s’en allaient au cellier, après avoir pris dans le buffet une croûte de pain qu’ils trempaient dans leur verre rempli coup sur coup à la barrique même. Puis, quand ils avaient bu à sentir le vin clapoter dans leurs ventres, le père tapotait le bois sonore du fût pour écouter si le niveau du liquide avait baissé.
Le marquis demanda :
— Ce sont eux qui travaillent autour du morne ?
— Oui, oui, parfaitement.
Juste à cet instant, les deux hommes s’éloignèrent à grands pas de la roche chargée de poudre ; et toute la foule d’en bas qui les entourait, se mit à courir comme une armée en déroute. Elle fuyait vers Riom et vers Enval, laissant tout seul le gros rocher sur une petite butte de gazon ras et pierreux, car il coupait en deux la vigne ; et ses alentours immédiats n’étaient point encore défrichés.
La foule d’en haut, aussi nombreuse que l’autre maintenant, frémit d’aise et d’impatience ; et la voix forte de Petrus Martel annonça : « Attention ! la mèche est allumée. »
Christiane eut un grand frisson d’attente. Mais le docteur murmura dans son dos :
— Oh ! s’ils ont laissé toute la mèche que je les ai vus acheter, nous en avons pour dix minutes.
Tous les yeux regardaient la pierre ; et soudain un chien, un petit chien noir, une sorte de roquet, s’en approcha. Il fit le tour, flaira et découvrit sans doute une odeur suspecte, car il commença à japper de toute sa force, les pattes roides, le poil du dos hérissé, la queue tendue, les oreilles droites.
Un rire courut dans le public, un rire cruel ; on espérait qu’il ne s’en irait pas à temps. Puis des voix l’appelèrent pour l’écarter ; des hommes sifflèrent ; on essaya de lui lancer des cailloux qui n’arrivèrent pas à mi-chemin. Mais le roquet ne bougeait plus et aboyait avec fureur contre le rocher.
Christiane se mit à trembler. Une peur atroce l’avait saisie de voir cette bête éventrée ; tout son plaisir était fini ; elle voulait s’en aller ; elle répétait, nerveuse, balbutiant, toute vibrante d’angoisse :
— Oh ! mon Dieu ! Oh ! mon Dieu ! il sera tué ! Je ne veux pas voir ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Allons-nous-en...
Son voisin, Paul Brétigny, s’était levé, et, sans dire un mot, il se mit à descendre vers le morne de toute la vitesse de ses longues jambes.
Des cris d’épouvante jaillirent des bouches ; un remous de terreur agita la foule ; et le roquet, voyant arriver vers lui ce grand homme, se sauva derrière le roc. Paul l’y poursuivit ; le chien passa encore de l’autre côté et, pendant une minute ou deux, ils coururent autour de la pierre, allant ou revenant tantôt à droite, tantôt à gauche, comme s’ils eussent joué une partie de cache-cache.
Voyant enfin qu’il n’atteindrait pas la bête, le jeune homme se mit à remonter la pente, et le chien, repris de fureur, recommença ses aboiements.
Des vociférations de colère accueillirent le retour de l’imprudent essoufflé, car les gens ne pardonnent point à ceux qui les ont fait trembler. Christiane suffoquait d’émotion, les deux mains appuyées sur son cœur bondissant. Elle perdait tellement la tête qu’elle demanda : « Vous n’êtes pas blessé, au moins », tandis que Gontran, furieux, criait : « Il est fou, cet animal-là ; il ne fait jamais que des bêtises pareilles ; je ne connais pas un semblable idiot... »
Mais le sol oscilla, soulevé. Une détonation formidable secoua le pays entier, et, pendant près d’une longue minute, tonna dans la montagne, répétée par tous les échos comme autant de coups de canon.

Christiane ne vit rien qu’un pluie de pierres retombant et une haute colonne de terre menue qui s’affaissait sur elle-même.
Et aussitôt, la foule d’en haut se précipita comme une vague en poussant des clameurs aiguës. Le bataillon des marmitons bondissait en dégringolant la butte et laissait derrière lui le régiment des comédiens qui dévalait, Petrus Martel à leur tête.
Les trois ombrelles tricolores faillirent être emportées dans cette descente.
Et tous couraient, les hommes, les femmes, les paysans et les bourgeois. On en voyait tomber, se relever, repartir, tandis que sur la route les deux flots de public, refoulés tout à l’heure par la crainte, roulaient maintenant l’un vers l’autre pour se heurter et se mêler sur le lieu de l’explosion.
— Attendons un peu, dit le marquis, que toute cette curiosité soit apaisée, pour aller voir à notre tour.
L’ingénieur, M. Aubry-Pasteur, qui venait de se relever avec une peine infinie, répondit :
— Moi, je m’en retourne au village par les sentiers. Je n’ai plus rien à faire ici.
Il serra les mains, salua, et s’en alla.
Le docteur Honorat avait disparu. On parlait de lui. Le marquis disait à son fils :
— Tu le connais depuis trois jours et tu te moques tout le temps de lui, tu finiras par le blesser.
Mais Gontran haussa les épaules :
— Oh ! c’est un sage, un bon sceptique, celui-là ! Je te réponds qu’il ne se fâchera pas. Quand nous sommes tous les deux seuls, il se moque de tout le monde et de tout, en commençant par ses malades et par ses eaux. Je t’offre une baignoire d’honneur si tu le vois jamais se fâcher de mes blagues.
Cependant l’agitation était extrême en bas, sur l’emplacement du morne disparu. La foule, énorme, houleuse, se poussait, ondulait, criait, en proie certes à une émotion, à un étonnement inattendus.
Andermatt, toujours actif et curieux, répétait :
— Qu’ont-ils donc ? Mais qu’ont-ils donc ?
Gontran annonça qu’il avait voir ; et il partit, tandis que Christiane, indifférente maintenant, songeait qu’il aurait suffi d’une mèche un peu plus courte pour que son grand fou de voisin se fît tuer, se fît éventrer par des éclats de pierre parce qu’elle avait eu peur pour la vie d’un chien. Elle pensait qu’il devait être, en effet, bien violent et passionné, cet homme, pour s’exposer ainsi sans raison, dès qu’une femme inconnue exprimait un désir.
On voyait, sur la route, des gens courir vers le village. Le marquis, à son tour, se demandait : « Qu’est-ce qu’ils ont ? » Et Andermatt, n’y tenant plus, se mit à descendre la côte.
Gontran, d’en bas, leur fit signe de venir.
Paul Brétigny demanda :
— Voulez-vous mon bras, madame ?
Elle prit ce bras qu’elle sentait aussi résistant que du fer ; et, comme son pied glissait sur l’herbe chaude, elle s’appuyait dessus ainsi qu’elle aurait fait sur une rampe, avec une confiance absolue.
Gontran, venu à leur rencontre, criait :
— C’est une source. L’explosion a fait jaillir une source !
Et ils entrèrent dans la foule. Alors les deux jeunes gens, Paul et Gontran, passant devant, écartèrent les curieux en les bousculant, et sans s’inquiéter des grognements, ouvrirent une route à Christiane et à son père.
Ils marchaient dans un chaos de pierres aiguës, cassées, noires de poudre ; et ils arrivèrent devant un trou plein d’eau boueuse qui bouillonnait et s’écoulait vers la rivière, à travers les pieds des curieux. Andermatt était déjà là, ayant traversé le public par des procédés d’insinuation qui lui étaient particuliers, disait Gontran, et il regardait avec une attention profonde sourdre du sol et s’échapper cette eau.
Le docteur Honorat, debout, en face de lui, de l’autre côté du trou, la regardait aussi avec un air d’étonnement ennuyé. Andermatt lui dit :
— Il faudrait la goûter, elle est peut-être minérale.
Le médecin répondit :
— Elle est certainement minérale. Elles sont toutes minérales ici. Il y aura bientôt plus de sources que de malades.
L’autre reprit :
— Mais il est nécessaire de la goûter.
Le médecin ne s’en souciait guère :
— Il faudrait au moins attendre qu’elle soit devenue propre.
Et chacun voulait voir. Ceux du second rang poussaient les premiers jusque dans la boue. Un enfant y tomba, ce qui fit rire.
Les Oriol, père et fils, étaient là, contemplant avec gravité cette chose inattendue, et ne sachant pas encore ce qu’ils en devaient penser. Le père était sec, un grand corps maigre avec une tête osseuse, une tête grave de paysan sans barbe ; et le fils, plus haut encore, un géant, maigre aussi, portant la moustache, ressemblait en même temps à un troupier et à un vigneron.
Les bouillons de l’eau semblaient augmenter, son volume s’accroître, et elle commençait à s’éclaircir.
Un mouvement eut lieu dans le public, et le docteur Latonne parut, un verre à la main. Il suait, il soufflait, et il demeura atterré en apercevant son confrère, le docteur Honorat, un pied posé sur le bord de la source nouvelle comme un général entré le premier dans une place.
Il demanda, haletant :
— Vous l’avez goûtée ?
— Non. J’attends qu’elle soit propre.
Alors le docteur Latonne y plongea son verre, et but avec cet air profond que prennent les experts pour déguster les vins. Puis il déclara : « Excellente ! » ce qui ne le compromettait pas, et tendant le verre à son rival : « Voulez-vous ? »
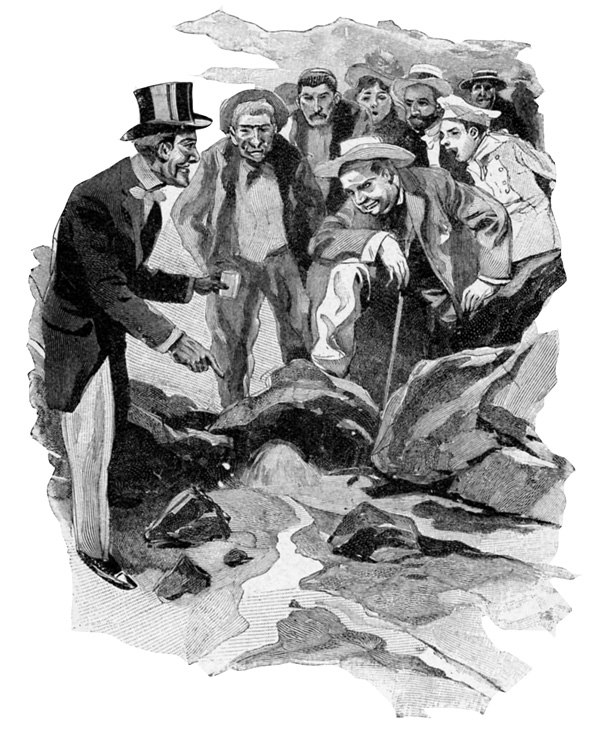
Mais le docteur Honorat, décidément, n’aimait pas les eaux minérales, car il répondit en souriant :
— Merci ! Cela suffit bien que vous l’ayez appréciée. Je connais leur goût.
Il connaissait leur goût, à toutes, et il l’appréciait aussi, mais d’une façon différente. Puis, se tournant vers le père Oriol :
— Ça ne vaut pas votre bon cru !
Le vieux fut flatté.
Christiane avait assez vu et voulut partir. Son frère et Paul lui frayèrent de nouveau un chemin à travers le peuple. Elle les suivait, appuyée sur le bras de son père. Tout à coup, elle glissa, faillit tomber, et regardant à ses pieds elle s’aperçut qu’elle avait marché sur un morceau de chair saignante, couverte de poils noirs et gluante de fange ; c’était une parcelle du roquet déchiqueté par l’explosion et piétiné par la foule.
Elle suffoqua, tellement émue qu’elle ne put retenir ses larmes. Et elle murmurait en s’essuyant les yeux avec son mouchoir : « Pauvre petite bête, pauvre petite bête ! » Elle ne voulait plus rien entendre, elle voulait rentrer, s’enfermer. Ce jour, si bien commencé, finissait mal pour elle. Était-ce un présage ? Son cœur, crispé, battait à grands coups.
Ils étaient maintenant seuls sur la route, et ils aperçurent, devant eux, un haut chapeau et deux basques de redingote s’agitant comme deux ailes noires. C’était le docteur Bonnefille, prévenu le dernier, et accourant, un verre à la main, comme le docteur Latonne.
Il s’arrêta en apercevant le marquis.
— Qu’est-ce que c’est, monsieur le marquis ?... On m’a dit ?... une source ?... une source minérale ?...
— Oui, mon cher docteur.
— Abondante ?
— Mais, oui.
— Est-ce que... est-ce que... ils sont là ?
Gontran répondit avec gravité :
— Mais oui, certainement, le docteur Latonne a même déjà fait l’analyse.
Alors le docteur Bonnefille se remit à courir, tandis que Christiane, un peu distraite et égayée par sa figure, disait :
— Eh bien, non, je ne rentre pas à l’hôtel, allons nous asseoir dans le parc.
Andermatt était resté là-bas, à regarder couler l’eau.
| Chapitre I — | Première Partie, Chapitre II | — Chapitre III |