Pierre Borel et Léon Fontaine : Le destin tragique de Guy de Maupassant, d’après des documents originaux, éditions de France, 1927, pp. 11-23.
| Chapitre I — | Chapitre II | — Chapitre III |
Paris. — La chambre de la rue Moncey. — Maupassant veut être poète. — Une pièce en vers. — Maupassant dessinateur. — Argenteuil. — L’époque rabelaisienne.
À Paris, Maupassant occupa d’abord une modeste chambre au rez-de-chaussée d’une maison, 2, rue Moncey. Cette chambre était éclairée, si l’on peut dire, par une fenêtre donnant sur une courette où la lumière du jour ne paraissait guère. Un placard assez profond lui permettait d’y installer sa toilette et un réchaud à pétrole pour préparer au besoin un repas sommaire. Un lit Louis XIII à colonnes se dressait contre le mur garni au fond d’une tapisserie ancienne représentant une scène de chasse ; entre la cheminée et la fenêtre, une table lui servait de bureau. Comme il était employé dans la journée au ministère de la Marine, il travaillait fort tard dans la nuit, en absorbant des tasses de thé. J’ai passé avec lui bien des veillées dans cette chambre où il se nourrissait et se délectait de Rabelais, chantait des vers d’Hugo, de Baudelaire, de Louis Bouilhet qui l’avait initié à l’art des poètes, s’exaltait sur des pages de Flaubert, martelait en les récitant comme une mélopée les vers qu’il forgeait lui-même. Il répétait souvent avec Musset :
J’aime surtout les vers, cette langue immortelle.
C’est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas,
Mais je l’aime à la rage. Elle a cela pour elle
Que les sots d’aucun temps n’en ont pu faire cas,
Que le monde l’entend et ne la parle pas.
Serait-il poète, et poète dramatique ? Il n’avait pas d’autre ambition alors ; c’est l’influence de Flaubert et le succès de Boule de Suif qui l’y ont fait renoncer. Et n’est-ce pas à son travail acharné, à ses essais en poésie, qu’il doit d’avoir écrit en une aussi belle prose sa première grande nouvelle ? L’obligation de condenser sa pensée dans le moule du vers l’avait habitué à réfléchir et à donner plus de force à l’expression de ses idées et de ses sentiments. Aussi, la plupart des grands poètes sont de grands prosateurs. Que de rêves ébauchés dans cette petite chambre obscure de la rue Moncey, d’où il devait sortir bien armé, et déjà triomphant après Boule de Suif, comme un jeune coq de sa coquille !
C’est dans cette chambre que Maupassant écrit : La trahison de la comtesse de Rhune, ou Rhune trahi, pièce historique en trois actes pour laquelle Gustave Flaubert lui donna des conseils1.
Lorsqu’il n’écrivait pas, Maupassant s’amusait parfois à dessiner. Il mettait dans ses dessins, pris sur le vif ou dictés par son imagination, la même observation et le même humour à froid que l’on trouve dans ses écrits : l’amusant croquis que nous reproduisons devait servir à illustrer un de ses contes.
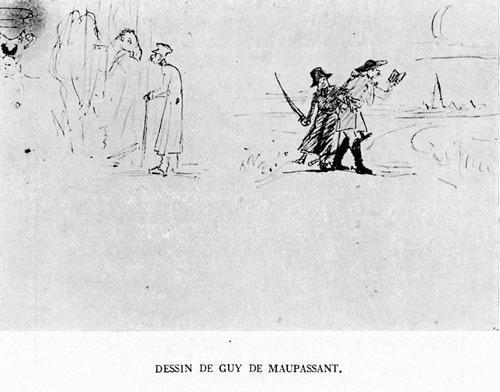
Dès les premiers jours du printemps, le sang de Guy bouillonnait dans ses veines avec la sève des plantes ; il ne pouvait plus rester à Paris, il avait soif de grand air et de campagne. Nous avions loué une chambre que nous partagions dans une guinguette d’Argenteuil tenue par un nommé Betry Simbosel, à l’enseigne du « Petit Matelot » ; et cette chambre se transformait en dortoir les soirs où nos amis étaient réunis. Dans une nouvelle intitulée Mouche, Maupassant a raconté, en les « romançant » un peu, ses souvenirs de canotier et les joyeuses équipées de ses camarades.
« Cette nouvelle de Mouche, a écrit Henry Céard, dans une chronique de l’Événement, lors de sa publication dans Paris, cependant guère facile à l’enthousiasme, souleva une clameur d’admiration. Les plus sceptiques et les plus blasés sur les succès de l’art ou de la littérature s’arrêtaient ce jour-là et se demandaient entre eux sur le boulevard : “Avez-vous vu la Mouche ?” »
Voici en quels termes Maupassant nous dépeint dans cette nouvelle :
« Nous étions une bande, aujourd’hui des hommes graves... Il y avait un petit très malin, surnommé Petit-Bleu... ; un autre spirituel et paresseux surnommé La Tôque ; un mince, élégant très soigné, surnommé N’a-qu’un-œil, parce qu’il portait un monocle, enfin moi qu’on avait baptisé Joseph Prunier. »
II y en avait bien d’autres, également affublés de sobriquets, mais ces quatre-là formaient le noyau de la petite bande, les fidèles, les inséparables, qui d’ailleurs sont toujours restés indissolublement unis. Hélas ! sur les quatre, il ne reste plus que N’a-qu’un-œil, avec son éternel monocle vissé à l’arcade sourcilière, et l’esprit aussi alerte que jadis, et Petit-Bleu, votre serviteur, lequel, quoi qu’en dise Maupassant, n’a jamais été un homme grave ; il est peut-être malin, c’est-à-dire avec un grain de sel, comme disaient les anciens, et il a par bonheur le cœur toujours neuf.
Joseph Prunier était alors féru de Rabelais ; il en goûtait particulièrement « la substantifique moelle », s’esbaudissait de sa verve et de la savoureuse richesse de sa langue. Nous ne parlions plus et nous ne nous écrivions plus qu’« à la manière de » Rabelais. Aussi, on peut juger de sa joie en découvrant dans la Tentation de saint Antoine, que venait de publier Flaubert, un petit dieu ancien peu connu, quoique bruyant et retentissant. C’est Crépitus, puisqu’il faut l’appeler par son nom. Prunier fonda l’Union des Crépitiens, qui avait ses statuts et ses rites. Pour en faire partie, il fallait subir des épreuves et une initiation burlesques, auxquelles s’appliquait son esprit inventif de farces gauloises et de mystifications.
Le 28 août 1873, sur du papier du ministère de la Marine, mon ami m’écrivait :
Épistre de Maistre Joseph Prunier, canoteur ès eaux de Bezons et lieux circonvoisins, au très honoré « Petit-Bleu » Roquetaillade.
Après fort nombreux apéritifs, nous mismes à banqueter 2 591 bouteilles de vin d’Argenteuil (je cuyde ce païs avoir été appelé Argenteuil parce que y faire toujours à Argent-œil, c’est-à-dire bon œil).
678 bouteilles de bon vin de Bordeaux (je cuyde ce païs avoir esté appelé Bordeaux parce que toujours y mettre beuvant en un verre au bord eau, mais jamais dedans).
746 bouteilles de Pomard (je cuyde ce vin avoir esté appelé Pomard parce que estre faict avec tant de Art que si le bergier Paris eust bû d’icelui, lui avoir baillé la pomme plustôt qu’à Vesnus comme dict Homerus).
27 941 muids de Ay (je cuyde ce vin avoir esté appelé ay par antinomie parce que n’estre pas haï, comme estre appelées furies euménides et comme estre appelé ambigu comique). Après ce commençâsmes à estre joyeux. Peu hasbitué à nos repas pantagruesliques, ce vieux c... de la Tôque commença à remuer de la pupille de si fascheuse et estrange façon, puis de plus estrange fascheuse façon encore remua de l’estomac, puis tomba par terre et ne remua plus du tout. Alors l’espongeames, le lavasmes, le frottasmes, le portasmes, le montasmes, le deshabillasmes, le couchasmes, tout désincornifistibulé, puis rescitasmes à son chevet prières et oraisons des pochards, ivrognes, vinitisants et aultres et lui dormit, ronfla, pétarada toute la nuict à tire larigot et se réveilla au demourant courbatu, espaultré, effroissé, teste, nucque, dours, poictrine, braz, et tout.
Et recommençames le lendemain.
Or, le jour où Dieu le père se reposa après avoir ciel et terre créé, arrivasmes à Bezons. Et fit Prunier, ce jour-là, moultes choses, tant estonantes, merveilleuses et superlives prouesses es navigation, assavoir, remorqua de Bezons jusqu’à Argenteuil une tant espouvantablement grand nauf vélifère que cuyda laisser peau des mains sur avirons (deux belles p... estaient dans cette nauf vélifère).
Signé : Joseph Prunier,
commandant de l’Étretat.
commandant de l’Étretat.
C’était aussi l’époque où Guy de Maupassant, terrible rival de Don Juan, se passionnait pour l’amour charnel ; il chantait alors la chair de la femme en des vers délirants :
Oh ! quand la chair se gonfle et se dresse brûlante !
Quand toute l’âme est là, tendue et pantelante,
Et la tête affolée — écumant de désirs,
Ne sachant où chercher de plus cuisants plaisirs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La respirer, sentir son odeur, la lécher
Avec l’emportement du bouc et du Satyre,
La sucer jusqu’au sang, la mordre, s’attacher
Comme une pieuvre humaine et la boire — et se rire
Qui se brise, et se gonfle en d’effrayants transports,
Dans ses crispations, des spasmes et des rages,
Étouffant, sanglotant, hurlant des cris sauvages !
C’est du pur paganisme.
Il y a entre Argenteuil et Bezons une île délicieuse, l’île Marante, bordée de grands peupliers d’Italie qui frissonnent au vent, que nous aimions particulièrement contourner. C’est le bouquet du pays. Elle est flanquée, du côté du petit bras, d’un îlot minuscule dont nous prenions possession. Nos amis, sinon les géographes, l’appelaient l’île du Petit-Bleu. Notre camarade Maurice Leloir, baptisé, Dieu sait pourquoi ? Chenet, laissait quelquefois l’aviron et prenait ses pinceaux ; il l’a peinte en un tableautin charmant de fraîcheur et de jeunesse. C’est en effet toute notre jeunesse que j’y retrouve en le regardant.
À propos de notre séjour à Argenteuil, je retrouve encore cette amusante lettre de Guy, datée du 14 août 1873 :
Comme je te l’ai promis, je viens te donner des nouvelles de la colonie d’Aspergopolis. J’y couche à peu près deux soirs par semaine et je fais des armes avec Boullaud de cinq à sept heures du matin. Outre cela, pas grand’chose de nouveau.
Dimanche, nous avons eu la visite de Paul, venant de Chatou avec Berthe.
Pour comble de misère, un camarade de Paul qui était venu avec eux s’est trouvé fort indisposé et incapable de retourner à Chatou, de sorte que j’ai été obligé de m’embarquer à dix heures du soir pour reconduire à leur nid ces deux tourtereaux voyageurs ; j’ai accompli sans accident ce dangereux voyage.
Que d’événements se sont passés depuis que j’ai commencé cette lettre !
D’abord, nous avons été à Bezons avec Mimi et Nini. Nous voulons monter en canot, Garachon l’avait loué ; il nous avait déjà fait le même tour dimanche dernier ; nous lui avons fait des observations ; et, comme il avait l’air de s’en moquer, nous lui avons annoncé qu’il n’avait plus à compter sur nous et que je viendrais mercredi soir solder ce que nous restons lui devoir ; aussi, tu serais bien aimable de m’envoyer par la poste les quinze francs que tu me dois encore sur un compte précédent et qu’il m’a déjà réclamés deux fois, plus ta part de la chambre, car je ne puis rien avancer, vu qu’on me doit encore vingt-cinq francs pour ces malheureux comptes d’Argenteuil, et il faut que je paye mercredi soir.
Vers la même époque, cette fois sur du papier du ministère de l’Instruction publique, Guy de Maupassant m’écrivait :
Mon cher Léon,
J’agis avec toi tout à fait sans gêne et je viens te demander si tu peux, sans te gêner aucunement, me prêter soixante francs jusqu’au Jour de l’an. Voici ce qui m’arrive. Je comptais sur quatre-vingts francs que me doit Peragallo, mais ses comptes ne seront liquidés qu’en janvier. La revue qui a pour titre La Réforme me doit cinquante francs pour mon Papa de Simon. Le directeur est malade et je ne serai payé qu’à mon retour. Enfin, Campion me doit toujours les trente-sept francs de Bezons. Total : un déficit de cent soixante-sept francs, et au premier janvier ma gratification et mes appointements.
Tout à toi :
Guy de Maupassant,
Guy de Maupassant,
des Cultes, des Beaux-Arts,
chargé spécialement de la correspondance du ministre
et de l’administration des Cultes, de l’Enseignement supérieur
et de la Comptabilité.
1 Cette pièce, que l’on trouvera à la fin du présent volume, n’a jamais été publiée ; si elle n’ajoute rien à la gloire de l’écrivain, elle nous montre en tout cas ses préoccupations littéraires à ce moment-là.
| Chapitre I — | Chapitre II | — Chapitre III |